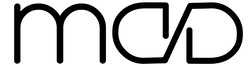Imaginée à partir des collections de la Cinémathèque française, l’exposition Le mystère Clouzot, organisée dans la Galerie des donateurs du Musée, revient sur l’itinéraire de ce « chercheur d’absolu », réalisateur des Diaboliques, du Salaire de la peur, du Mystère Picasso… Elle met en évidence un Clouzot souvent inattendu grâce à un parcours composé de maquettes de décors, storyboards, costumes, affiches, photos de tournages ainsi que des photos d’art méconnues, prises par Clouzot lui-même. Une rétrospective des films de ce grand nom du cinéma français classique accompagne l’événement.
Henri-Georges Clouzot ou la place du mort
« Vous êtes des esthètes du crime ! » Ce coup de chapeau, par lequel l’inspecteur Wens saluait les trois Durand de L’Assassin habite au 21, pourrait s’adresser à Clouzot lui-même : tout en reprenant les prétextes et procédés du genre criminel, il élude l’énigme du coupable à démasquer au terme d’une progression dramatique linéaire, pour lui substituer un jeu de miroirs autrement pervers. Dès son premier film – et les marionnettes sans visage qu’y fabrique Larquey –, le cinéaste installe le règne du mal non comme celui d’une « vérité » à découvrir mais d’une présence diffuse, impersonnelle, protéiforme, qui se dérobe dès qu’on croit la saisir. Cela passe d’abord par la confusion des repères narratifs, qui empêche le spectateur de s’identifier à une délégation rassurante de lui-même, et le laisse partagé entre des « doubles » aux contours indécis : Wens et Mila Malou, enquêteur bicéphale qui n’accède au cœur de l’énigme qu’au prix de menues duplicités.
Descente aux enfers
Ce dédoublement s’amplifiera dans Le Corbeau, où l’on sait encore moins à quel saint – ou démon – se vouer, entre le médecin au passé trouble et le psychiatre toxicomane ; et si la figure de l’inspecteur revient dans Quai des Orfèvres, puis dans Les Diaboliques, ce n’est que tard dans le récit, telle la réincarnation très humble et très ordinaire d’un deus ex machina qui serait impuissant à enrayer le cours des choses… Autour de cette loi absente, une culpabilité innombrable se déploie, qui est celle des cauchemars où le danger se cache derrière le familier ; aucun film de Clouzot ne résume mieux cette logique onirique que L’Assassin…, avec ses rues irréelles, peuplées de meurtriers indiscernables, avec son inquiétude d’autant plus révélatrice du climat de l’Occupation qu’elle s’exprime sous des dehors innocents. Aucun cinéaste n’aura plus lucidement vu venir le temps des assassins, dans toute l’acception collective du terme : un temps où chaque Français moyen peut s’avérer un salaud, où les catégories humanistes de la IIIe République sont gommées par l’omniprésence du soupçon : à l’anonymat multiple de Monsieur Durand fait écho, dans Le Corbeau, celui des lettres qui s’abattent sur Saint-Robin, et dont peu importe de démasquer l’auteur puisque tous ont été capables de les écrire. Et même si les Jenny et Maurice de Quai des Orfèvres ne sont pas directement responsables de la mort de Brignon, même si la Christina des Diaboliques ne l’est pas davantage – et pour cause – de celle de son mari, il suffit qu’ils aient porté le crime dans leur cœur pour n’être pas tout à fait innocentés. À la lettre, c’est à une descente aux enfers qu’invite Clouzot, selon autant de cercles qui renvoient indéfiniment à un nouveau vice, qui renvoient surtout le spectateur à sa mauvaise conscience. D’autant qu’au-delà des données lisibles du récit, le réalisateur ménage un espace vide, un no man’s land où le public se retrouve complice du mal par le seul fait d’y assister : c’est ce que traduisent les effets de caméra subjective dans les deux premiers films ; et, plus étrangement, ce prologue du Corbeau où il semble que ce soit la mort même qui emprunte nos yeux pour errer dans le cimetière, ouvrir la grille, toiser l’église qui domine la ville. L’idée sera reprise au cours de l’enterrement, lorsque le cinéaste nous impose le point de vue du défunt pour observer les paroissiens, juste avant qu’une nouvelle lettre ne s’échappe de la couronne mortuaire… Et c’est encore la mort qui apportera au film sa conclusion (?), sous le voile d’une vengeance qui s’éloigne en silence. Ce glissement vers un statut d’apprenti sorcier, qui compromettrait toutes les instances de la représentation, se renforce tout au long de l’œuvre – depuis un scénario de science-fiction (Le Monde tremblera de Richard Pottier) jusqu’à cette photo de classe des Diaboliques où se dessinent les traits du directeur disparu : il faut que le temps se dérègle ou s’arrête pour qu’on voie enfin cette place du mort d’où l’image est regardée.
Le diable est dans les détails…
Aussi bien, Clouzot privilégie l’angle fragmentaire et le détail, dont la collection maniaque ne vise qu’à reconstituer un crime qui n’a pas eu lieu, à exorciser un péché d’origine incertaine : sa crudité minutieuse n’a d’égal que le défaut d’incarnation de ses créatures. On a l’impression que son regard est trop coupable (trop conscient) pour laisser ses personnages assumer librement leur culpabilité ; la monstrueuse excroissance de son moi créateur ramène ses films à l’autocontemplation, en circuit fermé, d’un cinéma en train de se refaire, tout en leur interdisant ce dépassement initiatique proposé par ses maîtres Hitchcock ou Lang. Dans Le Corbeau, cela peut prendre la forme d’un expressionnisme rhétorique, qui trouve une célèbre illustration dans la scène où Larquey fait se balancer la lampe en dissertant sur le bien et le mal, l’ombre et la lumière… À partir des années cinquante et de la médiatisation internationale du cinéaste, cela deviendra une manipulation de plus en plus virtuose : du Salaire de la peur aux Espions, des Diaboliques à L’Enfer, Clouzot s’adonne à une surenchère spectaculaire dans l’expérimentation de la fiction et de ses pouvoirs mystifiants – jusqu’à se retrouver pris au piège de cette omniscience à la Mabuse. C’est d’ailleurs l’époque où il filme d’autres artistes, cherchant à ressaisir le mouvement de la création, quand la sienne se paralyse dans la démesure. Peut-être son génie ne s’est-il jamais mieux épanoui que sous la contrainte. C’était le cas dès L’Assassin…, où le modèle de la comédie policière made in Hollywood laissait libre cours à son goût des jeux de rôles. C’est encore plus vrai dans Quai des Orfèvres, qui marque, après le scandale du Corbeau, un parti pris de neutralité et d’invisibilité : on y relève à peine quelques effets manifestes, comme l’enchaînement elliptique des scènes d’introduction, qui ne fait qu’ajouter à la fluidité du découpage. Surtout, c’est le seul de ses films où, sans condamner d’emblée ses personnages, Clouzot les accompagne au plus épais du quotidien, avec leurs difficultés et leurs contradictions ; quitte à les abandonner à leur devenir, à la fois plus criminels et plus humains. Peut-être fallait-il en revenir aux codes du genre pour que ce cinéaste misanthrope se réconcilie (le temps d’un chef-d’œuvre) avec ses semblables.
Noël Herpe